

Le texte et les illustrations sont extraits de la brochure éditée à l'occasion de la rénovation de l'église Saint Georges en 1990. Texte de E. KAUFFEISEN avec la collaboration de Marcel KRETZ et de Jean PFIFFELMANN.
La première église de Rodern
Si l'extension du village de RODERN se situe au début du XIII° siècle, le premier lieu de culte fut sans doute très sommaire et la base de la tour de l'église actuelle - datant de la fin du XIII° siècle ou du tout début du XIV° siècle - serait donc le témoin de la première église de notre village. Nous avons la chance d'avoir le plan de cette première église grâce au devis estimatif proposé entre 1740 et 1750, après la décision de la communauté, en 1736, de rebâtir son église. (Document E 1061)
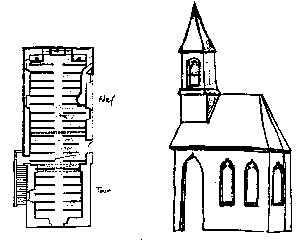
Nous voyons sur ce plan que la nef n'est pas plus large que la tour du clocher. Nous savons que cette nef est voûtée comme la tour et que le toit de cette nef a une pente très aiguë. Les bancs remplissaient l'église comme la base du clocher. II y avait une tribune avec entrée extérieure.
II n'y avait pas de choeur à cette église et, en dehors de l'autel principal, l'église comportait un autel de la Sainte Vierge et un autel de Saint Jacques (auparavant dédié à Sainte Dorothée et Saint Wolfgang). La porte d'entrée était située sur le côté sud de l'église. C'était une pièce du presbytère qui servait de sacristie : n'est-elle pas toujours appelée l'ancienne sacristie ?
Sur le retable de Rodern daté du début du XVI° siècle - actuellement à la Bibliothèque Humaniste de Sélestat - nous voyons saint Wolfgang présenter une église qui correspond en gros à ce que nous savons de la première église de Rodern. On peut penser qu'il y a là une représentation schématique de cette église gothique de Rodern.
Une église trop petite
Cette église était donc plus une chapelle qu'une église paroissiale. Or Rodern était église-mère vis-à-vis de RORSCHWIHR. Aussi, la communauté de Rorschwihr, désirant recevoir un prêtre résident, adresse, le 4 avril 1711, une supplique au Prince-Évèque de BALE, Jean Conrad de REINACH-HIRTZBACH.
Les fidèles de Rorschwihr - annexe de Rodern - soulignent les motifs suivants pour demander la séparation avec l'église-mère :
L'éloignement de près d'une heure de l'église de Rodern (en fait 25 minutes suffisent pour faire ce parcours par les vignes !), l'augmentation du nombre de communiants, l'exiguïté de l'église-mère, les difficultés de recevoir certains sacrements, le mauvais temps, un catéchisme souvent impossible à fréquenter pour les enfants et les jeunes, l'occasion de dévergondage qui menaçait la jeunesse livrée à elle-même. (Archives de PORRENTRUY A 19 b AAEP liasse 8.)
RORSCHWIHR obtiendra en 1720 la nomination d'un vicaire perpétuel - nomination confirmée en 1741. En fait, le problème se posait aussi pour RODERN dont la population augmentait rapidement (20 naissances par an en 1750); et puis l'église devait se ressentir aussi de la période de pauvreté qui suivit la guerre de Trente-Ans. Une ère de paix commençait, un peu partout on rebâtissait les églises. Rodern se décida donc à agrandir son église.
La décision de rebâtir l'église
C'est le dimanche 19 mars 1736 que l'Assemblée est convoquée et qu'après la messe dominicale tout le monde se retrouve à la Maison commune. II est donc décidé ce jour-là d'agrandir l'église et de financer les travaux par la vente de bois.
On peut faire quelques remarques sur les signatures qui suivent la décision. II y a 44 noms : le village est petit, comme on le voit. Sur ces 44 noms, on remarque que 10 personnes ne savent pas signer. II y a donc à Rodern une école assez efficace pour l'époque. II n'y a, il est vrai, que les hommes qui signent : le nombre de femmes illettrées devait être plus important. Les parents n'envoyaient qu'assez peu les filles à l'école.
Les noms sont écrits phonétiquement, par exemple KAUFISEN : il faudra attendre 1750 pour que ce nom retrouve son orthographe d'origine, KAUFFEISEN. Des noms sont le signe de l'arrivée à Rodern d'émigrants venus des Vosges : BENOIT, CHANTERAINE, GEDON (sur un autre document). Enfin, certains lieux-dits de la forêt ne sont pas identifiés.
Un premier projet entre 1740 et 1750
Quinze ans vont s'écouler entre la décision et le début de la réalisation. Même si l'on tient compte du temps nécessaire pour exécuter les coupes de bois et leurs ventes, ce délai de quinze ans paraît bien long. On ne peut guère envisager de contestation sur le projet lui-même, mais on peut penser que pour cette communauté, assez pauvre, le problème essentiel fut l'argent à trouver.
Un premier projet voit le jour (malheureusement, il n'est pas daté). II nous dit ceci : " On a projeté de ne pas toucher à la tour, que par une ouverture qui sera faite sur le côté ouest pour porter le jour dans l'intérieur du clocher qui continuera de faire partie de la nef ". " La sûreté du bâtiment défend de s'attaquer à la voûte et il y aura bien des frais de ménager ". II s'agit donc simplement d'ajouter un choeur et une sacristie à l'église telle qu'elle était. Le choeur sera voûté - comme la nef - en arc gothique. Sont prévus : la réfection de la toiture, de la nef et de la tribune, la mise en place de nouveaux bancs ainsi que trois fenêtres au choeur.
1 ° projet 2 ° projet (Eglise actuelle) La communauté fournira des manouvriers pour creuser les fondations des murs. Elle fournira des chênes, qu'elle fera mener à la scierie par corvée. La dépense se montera à 3 340 livres. La moitié de ce que va coûter le deuxième projet. Finalement, ce projet ne sera pas retenu, comme le montre le plan. L'agrandissement de l'église eut été nettement insuffisant.
Un deuxième projet, beaucoup plus radical et plus coûteux, voit le jour en 1751. Sans doute est-ce à la suite de cela qu'en 1751 trois membres du conseil de fabrique démissionnent en raison des dépenses extraordinaires occasionnées par les travaux - à venir - de l'église.
Un deuxième projet
Le 18 décembre 1751, l'accord est signé entre la seigneurie et la communauté. "Il faut se souvenir que Rodern est soumise à deux seigneuries représentées alors par le Prince Palatin, héritier des RIBEAUPIERRE, et Mr de BERNHOLD, héritier des RATHSAMHAUSEN. Cependant, seul le Prince Palatin est collateur de l'église. En cette qualité - bien que protestant - il reçoit la majeure partie de la dîme, mais doit entretenir le choeur de l'église. II venait d'acquérir en face du presbytère, en 1743, une nouvelle maison dîmière (Colmar E 2473), actuelle maison BLUMBERGER". (J. Pfiffelmann)
Le seigneur s'engageait à donner la somme de 900 livres pour la construction du choeur de l'église.
Le samedi 6 février 1752, les corvées de pierre sont organisées et les décisions furent sans doute proclamées le dimanche 7 février. 69 hommes sont requis pour ces corvées. On peut remarquer dans la liste les mêmes noms qu'en 1736, mais aussi beaucoup de noms nouveaux, signe que de nouvelles familles se sont installées à Rodern. Les notables paraissent en être dispensés. II est vrai que d'autres soucis les attendent.
Chaque corvée doit fournir environ 8 m3 de pierres, soit 184 m3 pour les 23 corvées. Un contrôle serré du travail est prévu. Treize boeufs et trois chevaux devront aider à ce travail.
L'adjudication des travaux
Le 17 février 1752, à 8 heures du matin, à la maison commune de Rodern, a lieu l'adjudication au rabais pour les travaux de la nouvelle construction de l'église de Rodern. L'annonce en a été faite à Colmar, Sélestat, Ribeauvillé, Bergheim, Guémar, Saint-Hippolyte, Sainte-Marie, Rorschwihr et Rodern, les 1, 2 et 3 février.
Le cahier des charges a prévu les fondations, les murs (3 pieds et demi d'épaisseur) du choeur et de la nef, le plafond de la nef, la toiture, la sacristie, la chaire, les bancs - comme ceux de l'église des Pères Augustins de Ribeauvillé - les portes, les fenêtres, la serrurerie.
La communauté fournit trois manouvriers par jour de travail ; elle creusera les fondations par corvées et se chargera du transport des matériaux; elle fournira le bois de sapin et de chêne.
Les 43 articles sont commentés et expliqués. " Le sieur Jean Kaufisen, maire, a été reçu en cette qualité responsable de tous les défauts de l'édifice et a signé ". Ce qui lui aurait coûté cher si la toiture avait été refaite, comme il en a été question ensuite.
Huit maçons vont essayer d'arracher le marché. Le premier prix proposé est de 6 000 livres. Finalement, c'est Joseph-Michel SCHNELLER, de GRUSSENHEIM, qui l'emporte pour 4 600 livres. Personne n'ayant proposé moins, à l'extinction des quatre bougies, le travail a été adjugé pour J.-M. SCHNELLER, Jean KAUFFEISEN acceptant d'être caution.
Les travaux
Le 4 mars 1752, après accord avec le bailli, l'autorisation est donnée de couper le bois. II faut remarquer que la commune demande de couper la totalité du bois dans la forêt de Bergheim, alors que le bailli ordonne d'en couper une partie dans la forêt de Rodern et l'autre sur Bergheim.
Les travaux avancent très vite et le 11 avril 1752, un litige est réglé avec Laurent SCHANTERIN (est-ce une germanisation du nom de CHANTERAINE ?). La commune lui donne un passage et il cède, en contrepartie, un peu de sa vigne pour permettre l'agrandissement du cimetière. " II s'agit de l'ancien cimetière, alors entièrement situé sur le tertre ; l'agrandissement s'est donc fait à l'est par la construction d'un mur afin d'étendre le tertre de ce côté, notamment pour permettre d'organiser des processions autour de l'église " (J. Pfiffelmann. )
De février 1752 à mars 1753, la construction de l'église est menée avec ardeur et rapidité. Les 69 hommes de corvée amènent les pierres, sans que l'on sache d'ailleurs de quelle carrière elles furent extraites (*).
(*) Un texte cependant, celui de 1755, mentionne que des pierres de taille seront tirées sur le "KLEGERBERG" ou bien au KOCKERSBERG.
Deux tailleurs de pierres venus d'OTTROT assurent la taille des pierres. Jean SCHREYECK dirige l'équipe des maçons qui élèvent peu à peu les murs de la nef, du choeur, de la sacristie et réalisent ensuite la voûte du choeur et le plafond de la nef. Joseph ANDRES, de BERGHEIM, fournit la chaux. Une dizaine de charpentiers et menuisiers, venus de BERGHEIM, CHATENOIS, LIEPVRE font la toiture, une partie du mobilier. Deux menuisiers de RODERN, Jean SCHÖPF et Christophe MÜLLER participent aux travaux. M. ACHTZECHNER, maître-forgeron, d'ERSTEIN, fournit les cadres métalliques des fenêtres. Antoine KRUMB, forgeron à RODERN, travaille avec lui. Sébastien REIHM fait les vitraux. Et quand Gaspard DEISS, serrurier à SAINT-HIPPOLYTE posera Ies serrures, tout sera terminé. Tout est conduit sous la direction de l'entrepreneur Maître SCHNELLER.
Il faut noter qu'il n'est pas mentionné de peintres ou d'artistes pour les tableaux des trois retables : la Vierge, Saint Jacques et Saint Georges pour l'autel principal. Ce mobilier fut sans doute exécuté plus tard. Peut-être lorsque la chaire - d'abord placée à droite de la nef (on y accédait par un passage partant de la sacristie) - fut ensuite placée à gauche de la nef. Ce qui permit la mise en place de l'autel de Saint Jacques. Le tableau de la Vierge a été remplacé après la Révolution par celui de la Vierge Marie protectrice de la famille de BOUG - certains visages seraient des portraits des enfants de la famille du SCHLÖSSEL. Le tableau ancien est une peinture agréable et simple qui a été fixée au mur sud de la nef. Le tableau du retable de Saint Georges a été replacé à l'entrée au moment où la fenêtre centrale a été ouverte.
C'est vraisemblablement à cette époque (1755) que l'ancien retable - actuellement à la Bibliothèque Humaniste de Sélestat - a été entreposé au grenier du presbytère de Rodern ; les goûts avaient changé ! Le 8 mars 1753, un procès-verbal d'inspection des travaux est dressé (il sera recopié en 1755) : une fissure à l'entrée du choeur est signalée... elle existe toujours ! Mais bien d'autres problèmes allaient se poser.
Contestations et oppositions
On pourrait penser qu'après cette visite, le récit de la construction de l'église s'achève : il n'en est rien. Une vive contestation s'élève : la communauté de Rodern n'est pas satisfaite de la construction et en appelle à l'Intendant de Justice, Mgr le baron de LUCE. C'est donc après deux ans de visites et de tractations qu'a lieu la rencontre suivante :
" L'an 1755, le 14 mars, en conséquence de l'ordre de Mgr le baron de LUCE, intendant de Justice, Police et Finances en Alsace, mis en tête de la requête des Bourgeois de RODERN, baillage de BERGHEIM, département de RIBEAUVILLÉ ; je soussigné, inspecteur particulier des Ponts et Chaussées, sous la direction de Mr de CLINCHAMP en ladite province, me suis rendu au dit RODERN pour, en présence des suppléants et du nommé Joseph Michel SCHNELLER, maître maçon demeurant à GRUSSENHEIM, lequel a entrepris et construit l'église du dit RODERN, pour faire une nouvelle visite de ladite église et reconnaître l'état de la construction, recevoir les dires des parties et en dresser procès-verbal, lequel être rapporté à Mgr Intendant qui en ordonnera ce qu'il appartiendra. Ceci étant, se sont retrouvés Messire Ignace JANZ, recteur de ladite paroisse, Jean-Georges STEINHEIL, registrateur, Archiver et Receveur de la seigneurie de BERGHEIM pour examiner la construction du choeur et de la sacristie appartenant au collateur ; Ignace KÜBLER, ancien prévôt, Franz-Joseph STÖRCKEL, nouveau prévôt, Jean KAUFFEISEN, maire et caution de l'entrepreneur, Antoine MÖBEL juré, François SCHEFFER idem, Antoine METZGER idem, Jean Georges LUTZ aufchutz, Mathieu MEYER idem, Martin SCHMITT der Jung idem, Antoine WOLFF ancien bourguemaître et Joseph Michel SCHNELLER entrepreneur. Avons en leur présence fait lecture et interprétation en allemand de tous les articles du devis des ouvrages les examinant et confrontant l'un après l'autre avec les parties de l'édifice existant ainsi qu'ils sont placés et énoncés en l'adjudication dont copie s'ensuit ". (document E 1061.)
II n'est pas possible de transcrire ce que fut cette nouvelle visite : minutieuse, exigeante ; on imagine sans peine que ce fut une réunion houleuse et difficile.
Certains articles du devis recueillent un satisfecit général, par exemple : " Les fondations ont été bien et duement faites conformément à l'article ci-contre (du devis) ". D'autres prêtent à contestation : les contreforts qui soutiennent l'arcade de l'entrée du choeur devraient être en pierres de taille, or ils sont en moellons. L'entrepreneur le reconnaît d'ailleurs. Mais surtout, la communauté pense qu'il faut refaire la charpente et la toiture de la nef et de la sacristie. C'est là que se situe la revendication principale présentée à l'intendant de la province. II y a aussi des problèmes financiers à clarifier.Enfin, une décision a été prise trop rapidement par Jean KAUFFEISEN : celle de faire un ossuaire, le mur du cimetière et deux latrines à l'école et à la maison commune (ce qui, à l'époque, représente un gros progrès). Jean KAUFFEISEN n'a pas suffisamment averti la communauté et, par malheur, l'entrepreneur a fait le mur du cimetière d'une façon insuffisante et à un prix trop élevé. Tout finira par se régler.
Finalement, la toiture ne sera pas refaite, par décision de l'intendant, et une nouvelle visite a lieu en avril 1755. Les comptes seront mis au clair, comme en témoigne le " règlement " des factures du 20 août 1755. Un protocole d'accord du 17 mai 1756 met un terme aux contestations.
Nous pouvons déceler en tout cela une opposition entre deux clans : celui du prévôt J.-J. STÖRCKEL et celui de l'ancien prévôt I. KÜBLER et de son beau-frère Jean KAUFFEISEN, maire et caution. Jalousies de village sans doute, mais aussi complexité de l'organisation de RODERN, partagé entre deux seigneuries. Mais en définitive, la communauté n'avait-elle pas joué jusqu'au bout son rôle de participation et de contrôle ? Bien avant la Révolution. Et la communauté n'avait-elle pas donné l'exemple d'une démocratie locale vivante ?
Dans la suite des années
D'autres frais vont apparaître. D'abord le mobilier de l'église, puis l'orgue.Démonté et remonté sur la nouvelle tribune, il a grand besoin de réparations. Un devis du 5 mars 1756 prévoit une dépense de 150 livres. Ce devis a été établi par Mr BOULAY, facteur d'orgues à Herlisheim.
En 1783, un projet de réparatlon du clocher ne semble pas avoir eu de suite.
En 1791, un texte émouvant témoigne de l'attachement de la communauté de Rodern pour son église. Le Conseil déclare :
" Nous avons édifié à neuf l'église il y a plus de 30 ans - (en fait, cela fait 40 ans) -. Tous les citoyens ont montré une émulation pleine d'ardeur, chacun a concourru de toutes ses forces pour mener à bien les travaux. Nous ne connaissons personne qui démolirait son propre travail. Nous pouvons assurer que l'on n'aurait aucun succès si l'on mettait en vente l'église. Nous n'avons personne qui cultiverait le champ où repose le reste de ses pères"
Au XIXe siècle
C'est en 1862 que le cimetière sera déplacé et aménagé à l'emplacement actuel. La grande croix sera érigée, en 1864, au fond du cimetière.

Photo de 1899En 1879, le clocher est modifié, surélevé et prend la forme actuelle. C'est sans doute à cette date que la fenêtre centrale du choeur est ouverte et que les vitraux actuels y sont placés.
Au XXe siècle
Le curé HINCKY fait repeindre l'intérieur de l'église en 1925 : " bien des paroissiens se souviennent encore de ce décor d'inspiration gothique ".
Dans les années 1950, l'extérieur de l'église est refait. Un nouveau coq-girouette remplace l'ancien, troué par de multiples balles - suites de la guerre.
Du temps de M. le curé STOEFFLER, l'église est repeinte - en 1962 - ; à cette occasion, l'autel principal est mieux mis en valeur et débarrassé d'ornements superflus.
En 1982, la fabrique de l'église demande à la manufacture d'orgues GUERRIER, de WILLER, de rénover les orgues de l'église.
En 1991, Rodern entreprend de remettre à neuf l' intérieur de son église. Le chauffage est posé dans le sol, le carrelage est refait. Les anciens bancs sont remplacés.
Le vitrail central du choeurDerniers travaux
En 1997, la peinture intérieure est refaite.

Inauguration de l'église rénovée le dimanche 22 juin 1997.